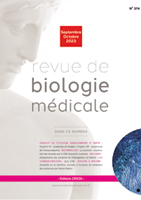Échos de presse
La "plus grande base de données médico-économiques du monde" accessible en Open data en février 2015
La base de données de santé Damir, gérée par l'Assurance Maladie, sera accessible en open data sur le site data.gouv.fr courant février 2015. Cette base est alimentée chaque année par les informations issues de 1,2 milliard de feuilles de soins, de 500 millions d’actes médicaux et de 11 millions d’hospitalisations.
Microbiote et norovirus : un modèle de mutualisme ?
par Frédéric Morinet *
Trois signalisations cellulaires, mettant en jeu les interférons de type I (α et β), de type II (γ) et de type III (λ), permettent le contrôle de la plupart des infections virales.
Les progrès en vue d'éliminer la rougeole sont au point mort, prévient l’OMS
Les progrès accomplis vers l’élimination de la rougeole sont au point mort, tel est l’avertissement lancé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le nombre de décès dus à la rougeole est en hausse : estimé à 122 000 en 2012, il est passé à 145 700 en 2013, d’après les nouvelles données publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS et le Morbidity and Mortality Weekly Report des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Une nouvelle molécule contre l'infection humaine à virus respiratoire syncytial
par Frédéric Morinet *
L’infection humaine à virus respiratoire syncytial (VRS) est responsable de deux entités cliniques : la bronchiolite hivernale du nourrisson et la pneumopathie interstitielle du sujet immunodéprimé, notamment en cas de greffe de cellules souches. Le diagnostic est aisé, par recherche directe des antigènes viraux ou PCR à partir des sécrétions respiratoires ou du lavage broncho-alvéolaire. Le VRS humain est classé en deux groupes A et B, le groupe A étant le plus prévalent.
Ebola, la fin des certitudes ?
par Frédéric Morinet *
Les virus Ebola sont des virus à ARN, enveloppés, appartenant à la famille des Filovirus. On distingue cinq sous-types : quatre sous-types africains (« Zaïre », « Soudan », « Bundibugyo », « Forêt de Taï » (anciennement « Côte d’Ivoire ») infectant l’homme à partir d’un réservoir toujours mal identifié (chauve-souris ?) et un sous-type asiatique (« Reston »). Le taux de mortalité est variable, oscillant entre 40-50 % (Bundibugyo et Soudan) et 70 à 90 % (Zaïre). Le sous-type Forêt de Taï a été à l’origine d’un seul cas, en Côte d’Ivoire, et le sous-type Reston a été uniquement identifié pour le moment en Asie et provoque une infection asymptomatique chez l’homme (1).
Solidarité renforcée des Etats membres en cas de crise sanitaire grave
Dès 2010, la réflexion de certains États membres, sur la pandémie de grippe H1N1 de 2009 a mis en lumière des faiblesses dans les mécanismes en place dans les pays de l’UE pour l’acquisition de vaccins et de médicaments. Il s’en est dégagé la nécessité d’introduire une procédure commune pour l’acquisition conjointe de contre-mesures médicales, et notamment de vaccins pandémiques, afin de permettre aux États membres, sur une base volontaire, de renforcer leur pouvoir d’achat et d’accéder de manière égalitaire aux marchés des vaccins et antiviraux.
Interactions hôte-bactérie : norovirus et Helicobacter pylori
par Frédéric Morinet *
Les norovirus représentent la première cause de gastroentérites virales à travers le monde et sont la principale cause de toxi-infections alimentaires d’origine virale en Europe et aux États-Unis. Ces petits virus de 34 nm de diamètre ont un génome à ARN et sont classés en cinq génogroupes distincts (GI-GV), qui comportent chacun plusieurs génotypes. Le génotype GII.4 est responsable à lui seul de 90 % des infections humaines.
Systèmes de santé : communication de la Commission européenne
Commission européenne
Communiqué de presse
Dans une communication adoptée le 04.04.2014, la Commission expose une stratégie de l’UE visant à armer les systèmes de santé européens face aux problèmes et aux tensions qu’ils connaissent. Elle met en avant des initiatives que l’Union peut développer et utiliser pour aider les États membres à garantir aux citoyens qu’ils bénéficieront des soins de qualité auxquels ils aspirent. Elle privilégiera les méthodes et les outils qui permettront aux États membres d’accroître l’efficacité, l’accessibilité et la capacité d’adaptation de leurs systèmes de santé, conformément aux recommandations de réforme adressées aux États membres dans le cadre du semestre européen.
Une nouvelle indication de la rivabirine : l'infection chronique à virus de l'hépatite E chez le sujet immunodéficient
par Frédéric Morinet *
Le virus de l’hépatite E (VHE), virus à ARN simple brin non enveloppé, a été découvert il y a une trentaine d’années et comporte quatre génotypes apparus il y a environ 500 ans. Les génotypes 1 et 2 sont une cause majeure d’épidémies à transmission oro-fécale (eaux souillés) en Asie et en Afrique, tandis que les génotypes 3 et 4 sont à l’origine de zoonoses impliquant divers réservoirs animaux (porc, sanglier, cerf...) en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, l’homme se contaminant par la consommation de viande mal cuite. Le diagnostic d’infection à VHE est généralement porté devant la constatation d’une élévation des transaminases qui conduit à pratiquer un bilan complet des virus des hépatites.
Journée mondiale de la santé 2014 consacrée à la prévention des maladies à transmission vectorielle
3 chiffres :
Dengue : 40 % de la population mondiale est exposée au risque de transmission de la dengue.
Paludisme : 1 minute : en Afrique, un enfant meurt du paludisme chaque minute.
Leishmaniose : 1,3 million de cas de leishmaniose surviennent chaque année.
Avec pour slogan « Petits mais dangereux », l’Organisation mondiale de la Santé consacre cette année le 7 Avril la Journée mondiale de la Santé, à la menace de plus en plus grande que représentent les maladies à transmission vectorielle.